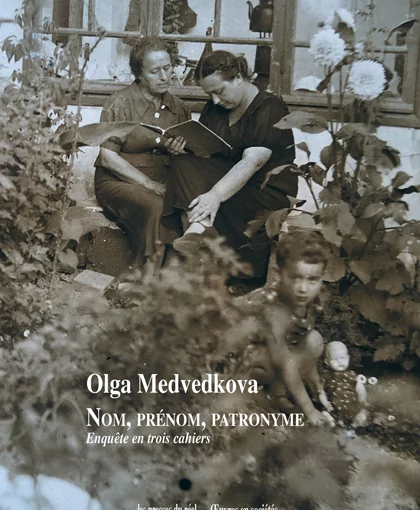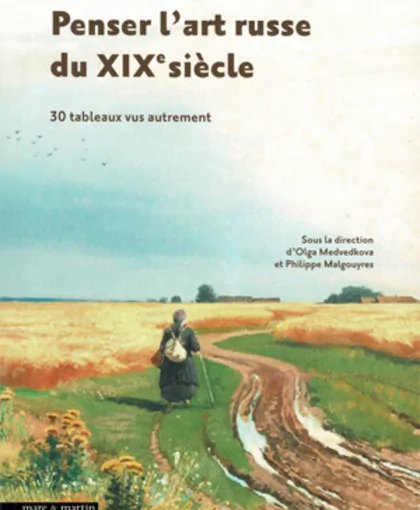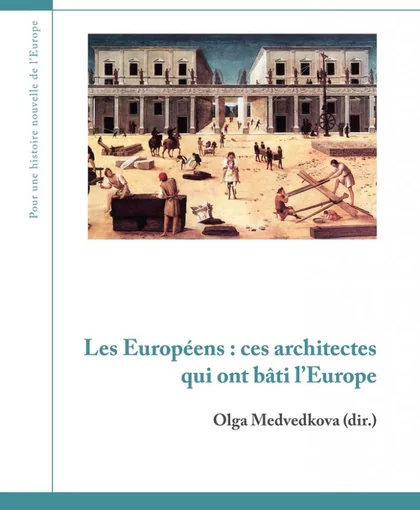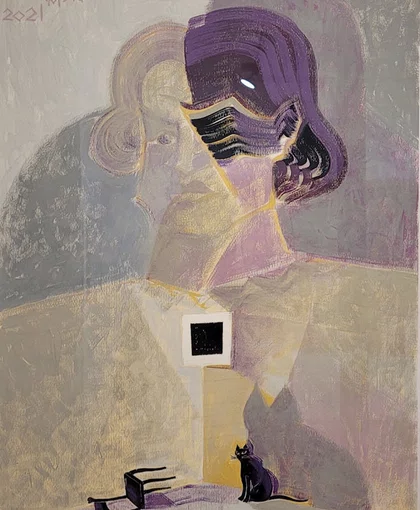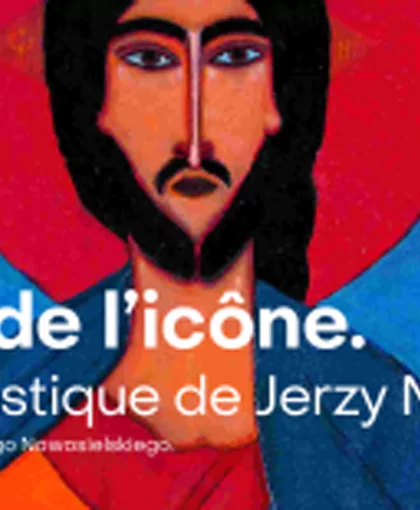Olga MEDVEDKOVA



Biographie
Olga Medvedkova est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire d'architecture moderne ainsi que de l'art russe et de la méthodologie de l’histoire culturelle.
- 2006 : Architectures imprimées. La circulation des modèles d’architecture dans l’Europe du xviie et du xviiie siècles, mémoire d’habilitation, université Paris-IV.
- 2000 : L'Architecture française en Russie au xviiie siècle, thèse de doctorat soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales, t. 1-2, Paris.
A – ETUDES et DIPLOMES UNIVERSITAIRES
2007 : qualifiée pour le corps des professeurs des universités par la Commission Nationale Universitaire.
2006 : habilitée à diriger les recherches, université de Paris-Sorbonne. Directeur : Claude Mignot. Composition du jury : Bruno Foucart, Sabine Frommel, Peter Fuhring, Marianne Grivel, Daniel Rabreau.
2001 : boursière à l’Ecole Française de Rome.
2000 : docteur en histoire et civilisation : thèse soutenue à l’EHESS, mention « très honorable avec félicitations à l’unanimité ». Directeur de thèse : Jacques Revel. Composition du jury : Bronizlaw Baczko, Georges Dulac, Antoine Schnapper, Véronique Schiltz, Michael Werner.
1992-2000 : doctorante à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
1985-1989 : doctorante en histoire de l'art, faculté d'Histoire, Université Lomonossov de Moscou.
1985 : diplômée d'histoire de l'art, Université Lomonossov de Moscou, mention « excellent », diplôme « rouge ».
1980-1985 : étudiante à l’Université Lomonossov, Moscou, faculté d’histoire, section d’histoire de l’art.
B – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : enseignement, recherche, responsabilités
2022-2023 : co-responsable des Rencontres du Centre André Chastel.
2022-2023 : vacation en Sorbonne Université, Master 2 Recherche en Histoire de l’Art, 1er semestre (Architecture moderne M3AA56HA) 2 heures par semaine (24 heures).
2022 (1 juin) : mutation vers le centre André Chastel (UMR 8150).
2020-2023 : professeure invitée pour 10 heures de cours en Sorbonne Université (Histoire de l’art, préparation au concours du patrimoine). L’architecture italienne de la Renaissance.
2021-2022 : professeure invitée pour 12 heures de cours en Sorbonne Université (UFR Etudes slaves). Histoire de l’art russe du XIXe et du XXe siècle.
2019-2022 : membre nommée de la comission Arts du CNL.
2020 : nommée co-directrice avec Pierre Caye du groupe THETA au centre Jean Pépin.
2018-2019 : professeure invitée pour un cours de 12 heures en Sorbonne Université (UFR Etudes slaves). Histoire de l'avant-garde russe.
2017 : membre du comité de rédaction de la revue « Histoire de l’art » de l’Institut national d’histoire de l’art, Moscou.
2015 : admise au concours 33/01 et nommée (à partir du 1 octobre 2015) Directrice de recherche de 2e classe.
2014 (1 septembre) : mutation vers le centre Jean Pépin (UMR 8230).
2010-2012 : chargée de conférences complémentaires à l’EHESS.
2009 (automne) : titularisation en qualité de chargée de recherche de 1ère classe.
2008 (1 octobre) : recrutée au CNRS en qualité de chargée de recherche (CR 1) ; affectée au centre André Chastel (UMR 8150).
2007-2008 : chargée de cours à l’Université de Genève (programmes BA et MA).
2004-2006 : chargée de cours complémentaires à l’EHESS.
2003-2007 : pensionnaire chercheuse à l’Institut National d’Histoire de l’Art.
2001 (depuis) : chercheuse associée au CERCEC (EHESS).
1996-1998 : lectrice à l'Université de Paris-IV.
1995-2002 : professeure d’histoire de l’art aux Ateliers de Sèvres, Paris.
1989-1992 : chercheuse en histoire de l'art, Institut d'Histoire de l'art de Moscou
C–PRIX ET DISTINCTIONS
2018 : prix Lequeux de l’Institut de France sur la proposition de l’Académie des inscriptions et des belles-lettres.
2014 : prix Révélation de la Société des Gens de Lettres.
2013 : prix IntrAduction du Festival d’histoire de l’art à Fontainebleau.
2007 : lauréate du prix Marianne Roland Michel (2007).
Publications
Ouvrages
Enseignement
Master 2 Recherche en Histoire de l’Art, 1er semestre (Architecture moderne M3AA56HA) - jeudi 14h-16h en salle Ingres à l’INHA
Écrire une nouvelle histoire d’architecture : entre histoire culturelle et histoire de l’art.
Olga Medvedkova, directrice de recherche, CNRS, centre André-Chastel.
Comment écrire aujourd’hui l’histoire de l’architecture moderne (de la Renaissance aux Lumières) ? En quoi les anciens modes d’écriture (stylistique, national, régional, monographique) peuvent-ils aujourd’hui paraître périmés ? Comment rendre à l’histoire de l’architecture son actualité et son intellectualité ? Quelle est la part de la théorie (souvent implicite, fragmentée) et de l’histoire (sources textuelles ou graphiques), de l’objectivité (croisement et lecture critique des sources) et de la subjectivité (observation, expérience personnelle, la fonction de fréquenter ou d’habiter) dans l’écriture de l’histoire architecturale ? Sur quelle certitude (ou incertitude : images, rêveries, mémoires) l’historien de l’architecture s’appuie-t-il ? Comment comble-t-il les lacunes ? Ce séminaire de recherche propose d’analyser les anciens modèles d’écriture et d’envisager de nouvelles approches entre l’histoire culturelle et l’histoire de l’art. Nous allons questionner le régime temporel, la hiérarchie des sources, la sélection des détails, le jugement esthétique que ces nouvelles approches proposent, ainsi que les notions de patrimoine, de mémoire, du temps long, de la morphologie et de la topologie architecturales.
Bibliographie conseillée (par ordre de parution)
I. Fondements théoriques :
- Vitruve, De Architectura (Les Dix Livres d’architecture, toute édition).
- Alberti, De Re Aedificatoria, 1485 (L’Art d’édifier, toute édition).
- Raphael et Baldassar Castiglione, La Lettre à Léon X (1519), éd. par Francesco Paolo Di Teodoro, trad de l’italien par Françoise Choay et Michel Paoli, Paris, les éditeurs de l’imprimatur, 2005.
- Vasari, Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti, 1550 (1568), toute édition.
- Palladio, I quatro libri dell’architectura, 1570 (Quatre livres d’architecture, toute édition).
- Quatremère de Quincy, Considérations morales sur la destination des ouvrages de l’art, Paris, 1815 (Paris, Fayard, 1989).
II. Approches méthodologiques :
- Jacob Burckhardt, La Civilisation de la Renaissance en Italie (1860), trad. fr., Paris, Bartillat, 2012.
- Alois Riegl, Le Culte moderne des monuments, son essence et sa genèse (1903), trad. fr., Paris, Seuil, 1984 ou 2013.
- Aby Warburg, « L’Art du portrait et la bourgeoisie florentine. Domenico GhirlandaIo à Santa Trinita. Les portraits de Laurent de Médicis et de son entourage (1903) », Essais Florentins, présentation par Evéline Pinto, textes traduits de l’allemand par Sybille Muller, Paris, Klincksieck, 1990, p. 101-135.
- Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, trad. fr. de Pierre Bourdieu, (particulièrement la 1ère partie : L’Abbé Suger de Saint-Denis, 1946), Paris, Les éditions de minuit, 1967.
- Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, première publication posthume, 1949, Paris, Armand Collin, toute édition, de préférence la dernière : 2018.
- Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanisme (1949) Les Principes de l’architecture à la Renaissance, trad. fr., Paris, Verdier, 1997.
- Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957 (11e édition, 2012).
- Frances A. Yates, The Art of Memory (1966), trad. fr. par Daniel Arasse, Paris, Gallimard, 1975.
- Rudolf Wittkower, Studies in the Italian Baroque, London, Thames and Hudson, 1975.
- Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, t. 1-3, Paris, Gallimard, 1984-1992 (voir particulièrement t. 1, La République, Les Monuments).
- L’Escalier dans l’architecture de la Renaissance, Paris, Picard, 1985.
- John Onians, Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance, Princeton University Press, 1990.
- James S. Ackerman, L’Architecture de Michel-Ange (1986), trad. fr., Bruxelles, Macula, 1991 (particulièrement chapitre VI : Le Capitole).
- Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1996.
- Salvatore Settis, Battaglie senza eroi. I beni culturali tra instuzioni e profitto, Milano, Electra, 2005.
- Roberto Gargiani (dir.), La Colonne. Nouvelle histoire de la construction, Lausanne, EPFL Press, 2008.
- Andrea Del Lungo, La Fenêtre, sémiologie et histoire de la représentation littéraire, Paris, Seuil, 2014.
- Jacques Derrida, Les Arts de l’espace, écrits et interventions sur l’architecture, Paris, éditions de la Différence, 2015.
- Alexandre Gady, Monique Chatenet (dir.), Toits d’Europe : formes, structures, décors et usages du toit à l’époque moderne (XVe-XVIIe siècles), Paris, Picard, 2016.
Autres
- Participation à l'émission Entendez-vous l'éco ? sur France Culture, Épisode 28/41 : L'économie selon... Vassily Kandinsky, le 21 avril 2022
-
Une collection de textes critiques à propos des expositions et des artistes contemporains :
https://desk-russie.eu/2023/07/22/quand-les-icones-se-mettent-en-route.html
https://desk-russie.eu/2023/06/10/ilya-kabakov-rejoint-le-futur.html
https://desk-russie.eu/2023/04/15/penser-l-art-russe.html
https://desk-russie.eu/2022/06/10/ilya-repine-pour-en-finir-avec-l-ame-russe.html
Adresse
Galerie Colbert
2 rue Vivienne
75002 Paris
France